
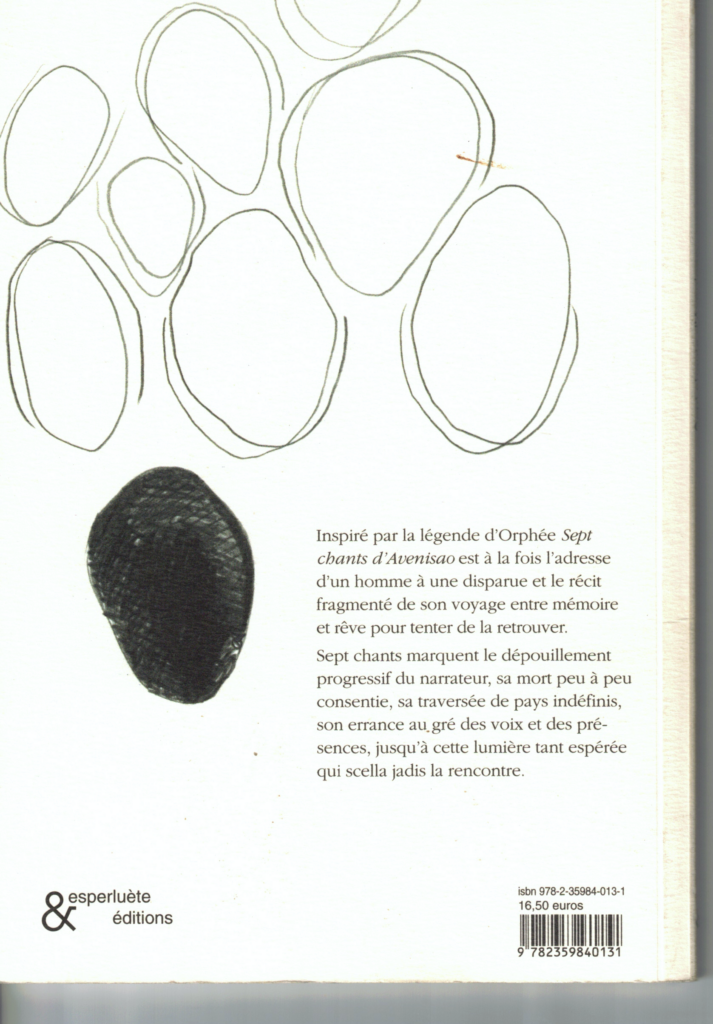
Édition: Éditions Esperluètes, 2010
La lecture des Sept chants d’Avenisao a été donnée en mars 2009 à la Ferme du Biereau de Louvain-la-Neuve sur une musique originale de Gilles Gobert, interprétée par l’Ensemble Nahandove
(Chant 1)
Alors que le jour se levait sur Amghor, que c’était Amghor à perte de vue, que nous y étions enfin, disaient mes guides, que nous étions enfin arrivés dans le territoire nommé Or, Amghor ou Abanghor ou dans leur langue chuchotée : Abanasset-désert, Abanasset grand marécage sec, mers asséchées d’Asset et d’Abanga, où la nuit même au feu de midi ne se séparait jamais de la terre, où le noir sous les pierres était glacé même au feu de midi, et où les vents erraient, débridés, tranchants et ravageants, assoiffés d’espaces, ces hordes en pagaille de vents aux milles lames, aux odeurs de métal, aux noms comme des cristaux, vents d’Ahe, vents d’Aguil, vent d’Aguiao, vents d’Aguieloun, vents tournoyant sans repos dans le chaudron glacé d’Abanghor, royaume, disaient-ils, des pierres et des vents, mais royaume sans royaume, invention du mot royaume pour ce qui n’était que terre nue à perte de vue, champs arasés nus, lacs de sel à perte de vue, croûte immense de boue séchée soulevée par la soif immense, et où enfonçaient mes pas après ceux de mes guides, traçant sans fin la saignée, la ligne d’enlisement de la route, au plus bas de la nuit comme sous le mat du soleil, mes yeux couverts d’un bandeau que mes guides m’interdisaient d’ôter sous peine, disaient-ils, d’éblouissement, d’errance à l’infini comme erraient les vents, dans ces terres basses d’Amghor, Abanghor, Abanasset-désert, jusqu’à ce que le soleil lentement me dessèche et réduise mon souffle, disaient-ils, à un ricanement de pépites
Mais qui m’avait parlé des caravanes folles qui voulaient remonter vers les mines, les gisements d’or bleu, la source absurdement des vents puis s’étaient enlisées dans les sables et dont on ne retrouvait que des ossements blancs parsemant les anciens tracés des routes ?
qui m’avait parlé des ouragans de pierre, terres crevassées, éperonnées par l’éclair, avec leurs fentes, leurs à-pics, leurs flaques au fond des failles comme les yeux de la pénombre, là où le sol s’ouvrait encore par secousses puis lentement refermait ses crocs noirs ?
qui m’avait parlé des bandes armées vivant sur tout le territoire, s’y partageant le jour et la nuit, la rive droite et gauche du fleuve asséché, STYX, et de ceux de Voïtera et de ceux d’Amartchak, les plus cruels, les pires, ceux qui tranchaient les sexes et les carotides, faisaient pendre au soleil les peaux ensanglantées de leurs victimes, et n’avais-je entendu dans la nuit hurler leurs chiens, ou siffler leurs balles, n’étais-je assez fou pour oublier que ma vie sauve tenait à un pacte fragile entre mes guides et Vato Amartchak, connaissais-je la cruauté d’Amartchak, avais-je seulement croisé son regard, et senti passer son rire, la lame, disaient-ils, la lame de son rire ?
Ce que balayait ma conscience
de son œil immobile
depuis le début de la marche,
depuis la fatigue ajoutée à la fatigue,
depuis que le sommeil m’effondrait chaque nuit comme un sac,
depuis que la voix du plus tendre de mes guides
se faisait plus tranchante,
comme glacée par l’effroi :
puisque tu l’as voulu,
étranger,
puisque le battant de la déraison cogne dans ton crâne,
puisque tu ne te connais plus comme on dit se connaître,
étranger
Et je sentais que je perdais mes forces, que je me vidais de mes forces, que je perdais mes images et mes forces, que je laissais derrière moi mes images, que j’entrais sans force dans une terre vierge d’images, Abanghor blanc, désert blanc, Abanasset blanc, Abanga blanc, blanc, blanc, immense paysage que balayaient les vents, les voix hélées de mes guides, cependant que se dévidait le fil infini, le harassant tracé de la marche, porter sans fin mon pas devant l’autre, sans fin laisser tomber l’une devant l’autre le fagot de mes jambes, et porter de plus en plus lourde la pierre de la marche, la vieille pierre des temps lourds, qui asséchait le souffle, et comme je me sentais vide, tu sais, comme je me sentais brisé, vide, comme je me sentais désormais sans plus d’attaches au monde, ayant laissé derrière moi toutes mes choses, mes innombrables petits fils de soie ou de nacre, mes plus lointaines adhérences, ce poudroiement d’images qui avaient été autrefois ma vie, et mes maisons et mes chambres, tout ce qui se murmurait autrefois dans les habitations de ma vie, et mon nom, peut-être même mon nom, que le plus affectueux de mes guides ne pouvait connaître, m’appelant Vahm, Ahm, Souahm ou Assouahm, qui voulait dire étranger mais tout aussi bien frère de soif, frère de traversée, frère d’humanité errante, compagnon de même fatigue, et l’eau, l’eau si claire, l’eau à odeur de roche qui dévalait depuis mes lèvres mon corps lorsqu’il me donnait à boire, l’eau pure qui me rinçait comme une lumière d’après l’orage, emportait ce que j’avais été, ce que j’avais cru être, et même mon nom, pensais-je, emportait même mon nom
Et mes petites maisons, mes pays d’autrefois, mes chambres, mes habitacles légers, légers, mes jardins, mes lointains chevaux de jadis, tout cet apparat de lumière et de rêve, la vie, le faste de ma vie là-bas, la traînée de mes voix, perdues parmi le temps, quand le temps était encore le temps, les jours et les jours, le rythme des nuits consolant des jours, et non cette implacable marche, enfoncement dans la marche, effacement du temps, poursuite implacable du vide, sous les ahanements de mes guides, et je pensais
même toi,
même cette inflexion de toi unique au monde,
même la fleur de toi unique au monde
s’émiettait avec la marche, la fatigue, et l’hostile main des vents
Quand me redressant d’un bond dans la lumière d’avant l’aube je me retournais pour voir
car il me semblait que tu m’avais appelé,
il me semblait peut-être,
j’avais cru entendre ta voix dans mon rêve de rêve
mais personne n’avait appelé,
il n’y avait pas de rêve,
ce n’était qu’une chute de pierre ou bien rien,
pure petite folie,
le corps craque quand il s’extrait de sa gangue de sommeil,
la terre tressaille entre loup et chien,
on entend dans le ciel la glace qui se fend
Car ne crois pas, disaient mes guides, ce que racontent ici les soubresauts, les mirages, tu es encore, mon petit frère, dans le premier âge de rien, tu n’es pas défait encore, tu tiens comme tu tiens toujours, c’est la fatigue qui te couche quand le fond de toi résiste, c’est la lourde main de la fatigue qui s’abat sur ton corps, écoute
autour de toi le paysage qui change, entend le choc de tes pas sur le sol dénudé, et l’écho d’échos contre les falaises de pierre, entends ce vaste vide où s’entrechoquent les voix, les vents ont effacé toutes traces mais on compte, disaient-il, on compte
cinquante à soixante à quatre-vingt milles de milliers de pas,
car ils comptaient mes guides avec une inquiète ferveur, ils comptaient le temps vaste et le vide, et l’un d’eux manœuvrait un instrument complexe de navigation quand un autre plaquait sa main aux doigts écartés contre le ciel nocturne ou traçait là-haut des lignes dans le pays des astres,
et pendant la marche du jour, il n’était pas rare que l’on fonde sur moi pour m’immobiliser, je sentais contre ma nuque une poigne et un souffle, comprenant qu’un danger était proche, puis quelqu’un lançait un cri à l’horizon de la plaine et nous reprenions la route avec une lenteur de convoi
Bientôt, bientôt, prévenait le plus affectueux de mes guides, bientôt ce serait fini, bientôt ce serait l’océan gelé à l’extrême bord, ce serait au bout de ta main là, indiquait-il, posant ma main sur l’horizon, et déjà les porteurs, les haleurs s’évanouissaient dans la nuit quand les autres n’avaient pas un mot avant de disparaître, quand me retournant vers la pénombre pour les chercher je m’apercevais qu’ils n’étaient plus là, seul lui, le plus tendre, jurait de ne pas me laisser encore, de me tenir la main jusqu’à l’extrême fin, m’intimant de ne pas craindre, et de sa voix calme, mélodieuse, sentir, disait-il, sentir
la petite fin des choses,
l’avancement du rien,
toi seul, mon petit frère, murmurait-il,
lui l’affectueux, le tendre,
toi seul
dans les territoires
et rien que les vents
pour te
guider
p.5-19