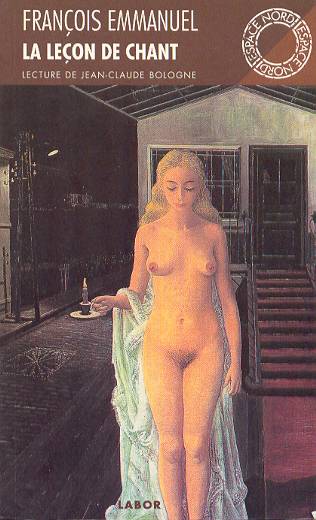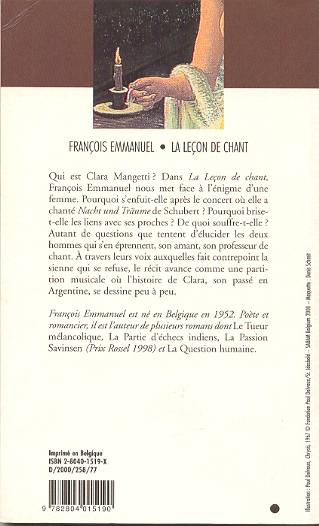Puis tous saluent ensemble, avec un rien d’empressement peut-être, afin de laisser se recouvrir sous le vacarme des applaudissements l’irréparable de ce cri à peine proféré : Oh je veux le suivre… Déjà, la traîne de la voix de Marthe est comme assourdie et tout rentre dans l’ordre des concerts, des morceaux de choix, des programmes sur papier glacé, des musiciens et des mélomanes.
On fit des recherches sur les partitions délaissées de Schubert, on voulut croire qu’il existait des feuillets oubliés, on retrouva trace d’une première exécution de la cantate deux ans après la mort du compositeur et l’on sut ainsi qu’elle fut donnée à Vienne, en l’Eglise Sainte-Anne, dans le même état d’inachèvement. Il faut croire qu’il y eut alors un instant de stupeur, le froid soudain très vif, car Franz Schubert était mort depuis peu et sa mort ressemblait à ceci exactement : une voix lancée au ciel et qui brusquement s’arrête, un silence trop vaste. Ensuite les bruits de la rue s’insinuant dans le choeur de l’Eglise Sainte-Anne : calèches et sabots ferrés, cochers ou vendeurs hurlant, des enfants qui crient, le portail, le vent…
Et l’on s’interrogea longtemps. Certains disaient : Schubert avait trop de prétentions orchestrales, la recherche de trop d’effets avait encombré la voix qu’il portait en lui, d’où son geste agacé de repousser la feuille et remettre à plus tard la composition. D’autres commentaient à mi-voix : il chantait la mort depuis toujours, comment ne pas comprendre la gageure de chanter la résurrection. Il fallait réentendre tous ses lieder à la nuit, à la soeur, à la lune, à la mort… Et quel visage il aimait lui donner : Le midi brûlant est passé, dans l’ombre froide t’attend le doux repos… Epurement de sa musique, Lazare meurt, c’est un chant admirable, une entrée dans l’eau des ténèbres, mais à mesure que s’approche l’épilogue, trop de sons clairs en perspective, trop de joies convenues, trop d’harmonies radieuses que Schubert ne ressent pas. Il délaisse la plume et part au hasard dans les rues de Vienne pour guetter quelque ami, planter un verre sur une table, y retrouver ce vieux fond d’ombre où se ressource le mal noir, la nostalgie.
Clara interprétait Marie dans la Cantate. Sur le livret Marthe est plaintive et Marie est douce, presque sereine face à la mort, et Schubert rassemble pour elle, comme pour Lazare ou Nathanaël, ses accents les plus purs.
Tout au long de la cantate j’étais aimanté par son visage, sa bouche très ouverte et les scintillements de la lumière sur les pinces argentées de ses cheveux. Appliquée, bien posée sur la phrase apprise, sa voix comme une voile fragile, faseyant parfois dans les retombées du vent mais portant le chant sans trop de dommage. Le moment de bascule survint plus tard. Peut-être à son entrée en scène pour le lied en solo, peut-être dès l’interruption de la cantate, je ne sais. Je sais seulement l’après coup, l’assèchement de sa voix, le dévalement, la chute, la longue perte de sens qui infiltra ensuite sa vie, et tout le temps qu’il lui fallut avant que de ce chaos renaisse une forme. Enfin je garde, obstinément, tout au long de ce lent démêlement, la tache aveugle de Schubert dont j’ai l’idée qu’elle entra dans le silence de la cantate interrompue. Et je vois, je revois ce petit homme myope qu’on appelait Schwammerl et qui eût pu écrire pour elle, comme il écrivait pour Karolyn Esterhasy sans oser le lui dire, comme il demeurait fasciné aux abords de la jeune fille morte, découvrant dans cet accord avec la figure absente de l’aimée, ses plus belles inflexions musicales. »
p.31 à 33