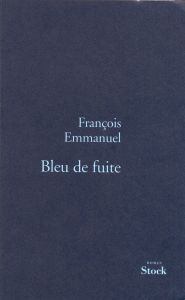

Édition : Editions Stock, avril 2005
« François Emmanuel, le salut dans la fuite » Gérard Meudal, Le Monde des Livres.
« Elle m’emmena au Santiague, où l’on brisait les verres au rythme des sambas, elle m’emmena à La Maison d’Orange où les garçons étaient en lavallière, elle m’emmena au Screamy où le plancher craquait sous les coups de la house music, elle m’emmena au Pianocktail où la Marseillaise était un délice vitriolé, tropical, elle m’emmena au Cha cha cha que l’on ne dansait pas, elle m’emmena au Fin de partie pour clore la série. Nous mangions en tête à tête, nous dansions, lorsqu’une piste s’offrait à nous, d’interminables parades. Lire la suite
Très saoule elle titubait sur la corde d’un vieux piano triste, rebondissait au son lancinant des congas ou entrait en transe dans le vacarme des musiques industrielles. Sa danse était souvent solitaire, ses yeux fixes dans un corps de déesse ophidienne, à l’état d’offrande intouchable. Vers deux heures du matin elle faisait appeler un taxi et tout se terminait par un baiser presque chaste, dans un hall saturé de lumière rouge, sous l’œil blasé du videur. Avant de danser, nous avions parlé d’abondance, mais qu’avions nous dit ? Nous avions ri mais de quoi ? Elle avait eu ça et là des mouvements de main distraite, des frôlements, des mots en libertinage, mais tout n’était encore qu’un jeu, d’invites et d’esquives, de dissimulations. Il eût fallu démêler le vrai d’autre chose, de ce qui se jouait de nous, sa pudeur, sa réticence, à moins d’un sombre calcul. Je m’enfonçais avec délice et inquiétude dans cet amour qui ne voulait pas dire son nom. Car je l’aimais trop, déjà. J’aimais ses airs poivrés de petite fille, cet instinct à me titiller, me provoquer, me saisir, me lâcher, me reprendre, affecter des mines graves, apitoyées, charmeuses, j’aimais la gamine dans un corps de femme faite, petit mais bondissant d’énergie, serré dans un jeans ou gainé d’une robe mauve, et souvent chaussé de baskets. J’aimais, sans oser la toucher, la nacre mouchetée de sa peau.
De quoi donc parlions-nous ? De poésie, de Somerset Maugham, de W.B. Yeats, du Nouveau Roman. Elle n’en connaissait pas grand chose mais elle étalait ce presque rien avec un talent de femme du monde abonnée aux cocktails littéraires. Elle riait encore à mes Leçons de Matière, partie émergée, disait-elle, de ma drôlerie involontaire. Je ne m’en offusquais plus. Les dialogues de Ménélas et d’Hélène nous lassèrent assez vite. Si la musique était douce, nous parlions de musique douce. Si nous étions environnés d’aquariums, nous parlions de poissons, les poissons nous emmenaient aux fonds des mers, des fonds nous remontions aux îles, des îles au sentiment d’insularité qui habite l’âme anglaise, de l’âme anglaise nous glissions vers l’âme russe ou, indifféremment, vers le peanut butter, selon les lois de la conversation linéaire qui se fraie un chemin d’un mot à l’autre, avec quelques bifurcations dans l’axe paradigmatique et quelques trous rapidement comblés par le vin. Au fil de ces bavardages, j’appris deux ou trois choses d’elle, je sus qu’elle détestait Wagner et les vases chinois, qu’adolescente elle avait fait du théâtre, qu’elle rêvait souvent de limaces (des limaces autour de son lit, des armées de limaces au sillage argenté) et qu’elle avait une chatte noire nommé Chi Salang. Une histoire d’animal écartelé, raconté sur le ton de la délectation, ne me mit pas sur mes gardes. Je pris cela pour de l’humour anglais, une gentille cruauté enfantine qui pimentait son charme. De son côté elle ne semblait pas trop intéressée à ma vie, ce qui au fond me rassurait. Nous vivions une sorte d’amour de vacance, elle en vacance de Markus Gün et moi en vacance de moi. Comme, à l’inévitable, le désir se mit à prendre un peu de place, voire à devenir encombrant, il y eut des moments de gêne, des glissements de langue, des lapsus trop sentis, de curieux coq à l’âne, de brusques silences. Un soir où elle était saoule elle m’offrit sa gorge à baiser, sa gorge et puis ses lèvres, elle me dit dans un souffle : mangez-moi, Louis, puis elle eut un mouvement d’effroi et me fixa de ses yeux sombres, soupira je suis vannée, le taxi s’impatiente, ensuite, quelques mètres plus loin, sur un ton de fausse insouciance : voyons nous demain soir au Chili and Pepper.
J’avoue qu’elle me prit par surprise. Jamais je n’avais imaginé qu’elle connaissait l’endroit. Craignant qu’elle y rencontre Aloïs Stein, je choisis une table plongée dans l’ombre. Derrière son sax, Stein fit mine de ne pas me voir mais dès qu’elle poussa la porte de la cave voûtée il se produisit un phénomène étrange. Le vieux cuivre l’aperçut, la salua, lui improvisa une entrée tout en caresses puis accompagna son long travelling déhanché entre les piliers et les tables. Elle était vêtue ce soir-là d’une barboteuse peau de pêche bleue avec bretelles et pantalon large coupé à mi-mollet. S’asseyant elle me dit ce sax a la voix d’un ange, un peu déchu certes, un ange postmoderne. Tous les anges sont devenus postmodernes, lui répondis-je, ils ne jouent plus du luth ou de la harpe, c’est à se demander comment Dieu s’y retrouve. Nous commandâmes un cocktail turquoise où flottaient des petits bouts de peau râpée, elle en but deux d’affilée, soupira quelques fois encore (Dieu, ce sax…), puis se lança seule sur la piste du Chilli, un étroit couloir entre les tables et c’est là que tout prit corps : Lou Summerfield, les yeux révulsés, les hanches mobiles, nageant dans l’eau tiède du jazz, plongeant, remontant, déployant des mains de palmipède, ouvrant ses bras comme des élytres, les repliant en savantes contorsions, redevenant congre, anguille, orphie, tandis que soyait la lumière sur le velouté onduleux de ses hanches, et tandis que le sax (Dieu, ce sax…) la couvait, l’enveloppait à distance, la léchait avec délice, lui passait des notes en catimini sous la barboteuse, au long des variations détricotées, ravaudées, étirées, interminables, de Mississipi Sunrise. On entendit même la voix de Joséphine qui éructa de plaisir. Après cet instant d’extase, il y eut Galoping Mare, puis la version chaude de Shangaï baby puis d’autres encore, j’en passe. Les clients du Chilli n’avaient plus d’yeux que pour elle, l’espèce de prémisse interminable à un numéro de strip-tease dont elle n’était jamais que la promesse, et la connivence secrète qu’ils se mitonnaient, Stein et elle, lorsqu’il venait lui chuchoter à l’oreille des ouaoua coulissants, irrésistibles. Vers trois heures du matin ces deux là étaient toujours ensemble mais elle accusait des signes d’épuisement. Je vins vers elle, je lui dis vous êtes trop belle, aujourd’hui je vous emmène. Elle mit un certain temps à comprendre mais se laissa tirer vers la sortie. Avec son sax Stein l’avait éreinté comme un vieux cuir, exténuée, rendue prête à tout. Dans le taxi déjà, puis dans le couloir, l’escalier, le hall d’appartement, la chambre, elle n’opposa pas de résistance à l’espèce d’animalité qui s’était emparée de moi. Certes il y eut quelques entraves, des boutons, des lacets, des fermetures-éclair coincées, tout un combat inesthétique contre la conspiration des frusques, mais à la fin de tout la barboteuse était au pied du lit, son corsage pendouillait sur la poignée de porte, et elle gisait totalement nue quoique soudain grelottante, affirmant qu’elle avait froid, sommeil, mal au crâne, et se pelotonnant en chien de fusil sous les couvertures. Par bonheur j’avais un vieux disque de Duke Ellington qui lui redonna quelques mouvements de couleuvre. L’amour, comme on dit, fut emballé dans ces reptations indolentes, mais au plus haut de l’amour, il me fallut bien comprendre qu’elle était avec le Duke et sans doute plus encore avec Stein, que Stein et son sax lui avaient fait l’amour pendant quatre heures mieux que personne et que j’arrivais beau dernier comme un moucheur de chandelles. Dans son sommeil elle gémissait encore : Dieu ce sax…
Elle dormit jusqu’au lendemain midi. Il y eut sans doute d’autres enlacements, des instants où elle se laissa mollement reprendre, mais je n’en ai pas grande souvenance, les nuits d’amour ne me laissent jamais que quelques détails dans une mer d’oubli. Ce sont des détails insignifiants ou fantasques, ainsi ces mouchetures rousses au dessous de sa gorge qui me firent penser à la partie Micronésie de mon vieux planisphère bistre, je revois aussi son corps nu derrière la vitre translucide de ma douche, ensuite elle flotte sans rire dans les jambes de mon pyjama à lignes. Vers quatre heures de l’après-midi, elle me regarde droit dans les yeux, elle me dit sombrement : cessons de nous raconter des histoires, Louis, parlez-moi de vous. Je lui racontai tout, Pavel Sobotkine qui s’était perdu dans le ciel mais cela ressemblait à de l’invention pure. De toute façon il vaut mieux oublier Ethel Amantya, me dit-elle, depuis qu’elle a quitté le monde des apparences, il vaut beaucoup mieux pour vous. Comme je désirais en savoir davantage, elle ajouta sèchement : je n’ai pas dit le monde des vivants, j’ai dit le monde des apparences, et j’ai dit aussi que c’était beaucoup mieux pour vous. Je n’en sus rien de plus. Une tristesse butée nous avait envahis l’un et l’autre. Vers le soir elle renfila son corsage et sa barboteuse comme autant d’atours qui s’étaient usés l’espace d’une nuit et semblaient soudain de seconde main. Ainsi rhabillée, elle m’embrassa sur le front, me confia dans un souffle : votre ami Bobotkine aurait dû en rester à la peinture. Elle n’ajouta pas : et vous, à la littérature, mais ce fut tout comme. Alors que je la suivais des yeux, petite tache bleue se perdant dans la foule des trottoirs, j’essayais de me souvenir de ses premiers mots au Prince de Mourmandeuil. Elle avait souri, elle avait dit vous êtes le premier poète-quelquefois que je rencontre en chair et en os.
La poésie est un art difficile. »
P.71-78