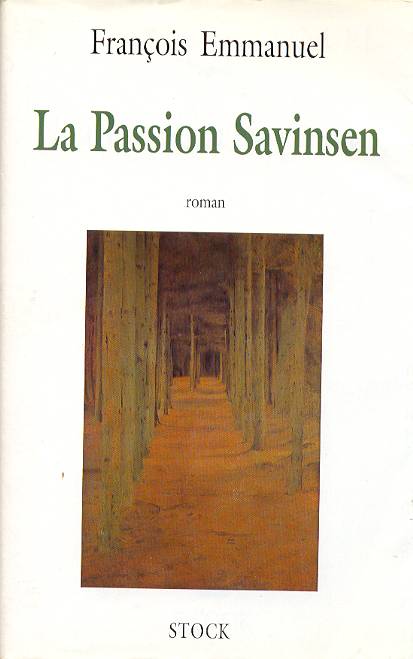
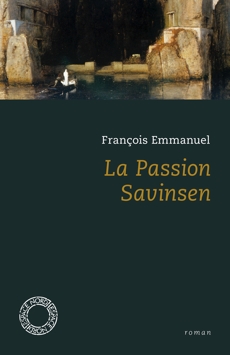
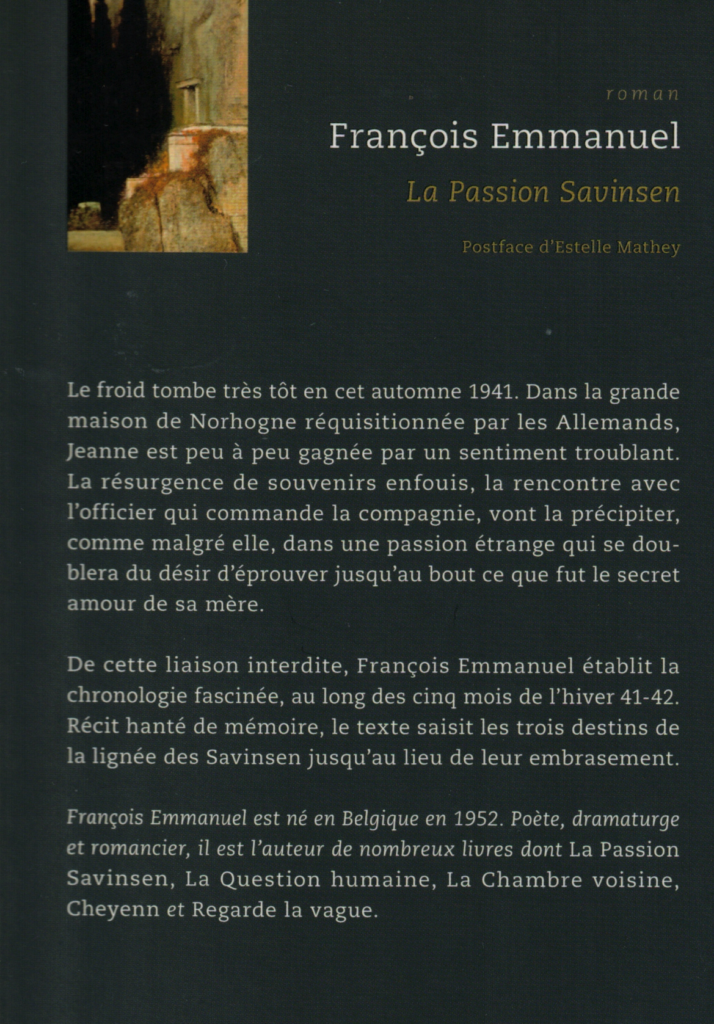
Édition: Éditions Stock, 1998
Réédition: Espace Nord, 345
PRIX ROSSEL 1998
Traductions:
Estonien : « Savinsenide Kirg » (chez Varrak) par Helle Michelson.
Roumain : « Patima Savinsen » (aux éditions Libra, Bucarest) par Tudor Ionescu.
Allemand : « Leid und Leidenschaften der Savinsens » (chez Shaker Verlag, Aachen) par Anne Begenat-Neuschäfer, Marie-Jacques Lueken, Marieke Gillessen, Vanessa Kayling, Angelika Schirmer et Mariele Vierhaus
Christophe Meurée, l’instrument qui rompt, in Textyle
« Ils tournaient autour de Norhogne et ces salves de coups de feu qui claquaient au loin, ces camions, ces jeeps américaines profilées sur l’horizon, ces brefs accès de musique populaire que le vent apportait de Noirhat ou de Saint-Sauveur, cette fête aux abois, fragmentée, éclatant de partout, semblait refermer ses cercles concentriques, comme une ronde aveugle, carnavalesque mais dont on n’apercevait pas encore les masques déformés et lubriques. Lire la suite
Le visage, le masque d’Ange Achenbach s’assombrissant toujours davantage tandis qu’il bougonnait contre Dieu sait qui, indifférent à la liesse lointaine, comme s’il savait à l’avance qu’ils finiraient bien par pousser jusqu’à Norhogne leurs cortèges imbéciles. Et cette précaution de Louise à engager le verrou branlant de la cuisine, parce que Ange l’avait alertée, allant même jusqu’à dire : s’ils en veulent, on leur donnera Camille, avec Camille ils seront servis, regrettant aussitôt ces paroles odieuses mais les ayant prononcées malgré lui parce qu’il y avait une ressemblance entre les hoquets jubilatoires de Camille et ces festoiements débridés, sauvages qui tournoyaient dans la chaleur de septembre. Puis enfin le troisième jour, vers le milieu de matinée, il fallut bien que ça arrive, c’était là, un visage hilare d’abord, coiffé d’un béret bleu et qui s’encadra dans la petite fenêtre de la métairie, puis, presque au même instant, un vacarme terrible dans la buanderie, deux hommes qui firent irruption par la porte de derrière, l’un d’eux saluant, s’excusant, messieurs-dames, minaudant qu’ils désiraient parler à la jeune comtesse, poser quelques questions à la jeune comtesse, madame la comtesse, bonjour. Et elle se dressa aussitôt, les suivit à l’extérieur jusqu’au camion bâché qui stationnait entre les deux piliers de la grille. Dans la benne du camion, sur le banc d’en face, il y avait un homme mal rasé, les mains appuyées sur le canon d’un vieux fusil à crosse de bois, et qui à intervalles écartait les jambes en étirant un sourire visqueux et béat, susurrant, sur fond du vacarme du moteur, des choses sales, insanes, avec le mot bitte qui revenait toujours et qu’elle ne comprenait pas, la peur, la peur étant alors partout, dans ce huis clos cahoté, interminable, cette lumière tamisée par les bâches claquantes, devant ce regard d’homme, fixe et salace, qui reviendrait plus tard dans les cauchemars, comme l’expression absolue de la perversion, du mal, du crime à venir, alors que la suite serait vécue hors d’elle, loin d’elle, comme un défilé d’images irréelles et grotesques.
La suite : le camion qui klaxonnait sous un porche, l’entrée lente dans une cour pavée, les visages des curieux soulevant la bâche, la longue attente au fond de la cour, debout, à côté d’une femme à tablier, à laquelle on avait donné une cigarette qui lui tombait des lèvres, une femme du peuple qui ne lui adresserait pas un mot de toute la cérémonie, pas un seul regard, mais à côté de laquelle ils avaient décidé de la faire figurer pour jouir du contraste des corps et illusoirement marquer aux yeux de tous l’égalité devant la faute. Longue station debout au fond de cette cour d’école alors que soudain personne ne semblait plus faire attention à elles, à part quelques regards de côté, des sourires, des propos échangés à distance, tous ces hommes à béret, brassard, écussons à croix de Lorraine, qui allaient et venaient sous le soleil, débarquaient des caisses, escortaient un homme aux poings liés, traversaient par groupes la cour, s’appelaient, se hélaient, s’esclaffaient, dans un désordre joyeux, mystérieux, mâle, sauvage. Puis vint ce jeune résistant d’à peine dix-huit ans qui lui demanda de le suivre au fond de couloirs faïencés, encombrés de caisses de victuailles, de matériel militaire, trépieds, barbelés enroulés, sacs de chanvre, jusqu’à la classe du premier étage où l’attendaient un homme plus âgé, assis à une petite table, et trois autres, affalés sur des bancs d’école qu’ils avaient repoussés contre les murs. Interrogatoire très doux, madame la comtesse, elle serre les poings pour ne pas être submergée par les larmes, elle répond d’une voix presque ferme, oui, Matthäus Hiele, oui, officier à la Kommandantur de C., ayant logé à Norhogne d’octobre 1941 à mars 1942, oui. Relations avec cet homme, il y a un silence. Avez-vous eu des relations sexuelles avec cet homme ? Elle est perdue, elle hoche la tête, oui. Bien, c’est fini, c’est simple. (Plus facile avec celles de la haute qu’avec ces petites catins dont il faut fouiller les sacs pour trouver les ausweis et l’argent chleuh.) Bien, attendez sur le palier, madame la comtesse. Le jeune résistant lui tend une espèce de biscuit sec qui lui fait une pâtée sèche dans la bouche, donne envie de vomir en même temps que reviennent ces mots bizarres de relations sexuelles, qu’elle n’a jamais entendu prononcer, ou prononcer de la sorte, comme une chose ainsi détachée au couteau, médicale, zoologique, et promenée sous le regard de tous, dans le silence, l’abomination Survinrent alors les cris de l’autre femme, hurlant que les Boches la forçaient, qu’ils lui mettaient un revolver sur la tempe pour la violer, et d’autres paroles effrayantes, noyées sous les quolibets et les rires. Enfin tous sortirent de la classe, pressés tout à coup, excités, l’un d’eux la poussant dans le dos avec le canon de son arme. Puis à nouveau le supplice du camion, à vous l’honneur, montez, madame la comtesse, l’un des hommes d’escorte lui passant un doigt sous la jupe, lui caressant la jambe jusqu’au pli de l’aine, suscitant un frisson charnel, violemment révulsif. Devant la mairie ils avaient monté une estrade, ils y avaient posé l’une à côté de l’autre deux chaises. Elle ne voit pas les gens autour de l’estrade, elle ne les entend pas, elle grimpe un à un les barreaux de l’échelle, s’assied sur la chaise, sent derrière sa nuque une main caressante qui soulève sa chevelure avec douceur, l’exhibe comme un panache blond, la laisse retomber, la soulève à nouveau, puis à partir du cou glisse le fil du rasoir au ras de la peau, la couvre bientôt de boucles blondes sur les épaules et la jupe. Elle s’enfonce les ongles dans la chair des cuisses pour ne pas pleurer, garder tête haute, elle cherche une image, Matthäus, image de Matthäus dressé devant la force lumineuse de la fenêtre, non pas nu dans la touffeur rougeoyante de la tourelle, non pas nu, jamais, mais lorsqu’il pleure sur le bureau de son père, ou lorsqu’il la regarde la première fois avec cet air préoccupé, tendre, parce qu’elle s’est fiancée sous ses yeux au cadavre du lieutenant français, cadavre de Matthäus au regard clair, diamantin, fixant le ciel à tout jamais dans un fossé enneigé, sans trace extérieure de blessure, mon amour, ils rient, ils crient : salope, découronnez-la, les aristocrates, je voudrais penser aux âmes, je voudrais croire qu’il y a Dieu, les âmes et que nous nous retrouverons, donnez-moi la force, Dieu, de ne pas baisser la tête. Ils dispersent ses cheveux dans la foule, ils les éparpillent en pluie d’or, en moisson de soie légère sous le soleil d’après-midi, puis ils la forcent à se lever. À cet instant, c’est Geninio qu’elle aperçoit dans la foule, Geninio, ivre, les yeux fous, campé sur ses jambes écartées et qui lui crie : FEMME, JE T’AIME, FEMME, JE T’AIME, d’une voix éraillée, tellement hurlante que les autres se sont tus. Et ce silence désormais elle le garde en elle, même s’ils ont recommencé à crier, la poussant en cortège jusqu’au perron de l’église. Elle marche aux côtés de l’autre femme, tête nue, au milieu des visages hideux de la fête. Sur le perron de l’église quelqu’un écrit avec un pinceau sur son front, non pas une croix gammée comme sur le front de l’autre femme mais un mot de quatre ou cinq lettres qu’elle ne connaîtra jamais. Elle connaîtrait seulement cette impression de trace froide, la sensation qu’ils savaient, qu’elle ne saurait jamais, le voulût-elle, ce mot qui subrepticement les faisait sourire, et que Louise effacerait en hâte, frottant énergiquement, répétant dans les larmes : des bêtises, madame, des bêtises. Ange affalé alors sur la table de la cuisine, ivre mort ou écrasé de honte, les deux sans doute, car il avait honte autant pour lui que pour elle, éprouvait la honte des gens de dévotion, de noblesse basse, la honte des métayers. Le soir même, Camille viendrait s’accroupir à l’angle de la pièce, avec ce regard écarquillé, fixe, de celle qui a tout vu, tout entendu, comprend mieux que personne la foudroyante extase du corps pénétré par le corps. Et le lendemain, Louise lui apporterait un fichu fleuri violet à la toile très fine, qu’elle garderait toute sa vie dans le tiroir où elle garda tous ses objets précieux, le relavant même quelques années plus tard, y passant régulièrement ses doigts comme on apprécie le corps d’un tissu diaphane, sans autre raison que l’attachement au souvenir logé entre ces mailles qui lui tinrent lieu pendant près d’un an de chevelure, de baume sanctifiant la douleur. Et la nuit elle ressentirait encore la main du tondeur sur son crâne, douce, anormalement, comme celle de son amant lorsque à large paume il lui caressait la tête, dénouait ses cheveux ou en lissait le fil, prononçant des paroles apaisantes, épiant, éveillant dans ses yeux la fragile promesse de l’éternité. »
P.151-157