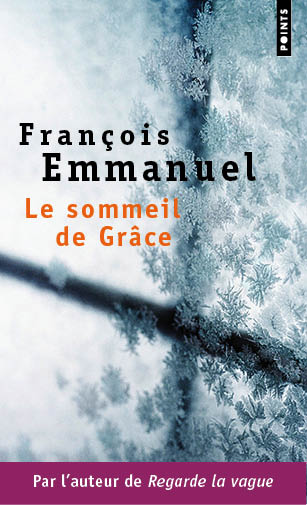
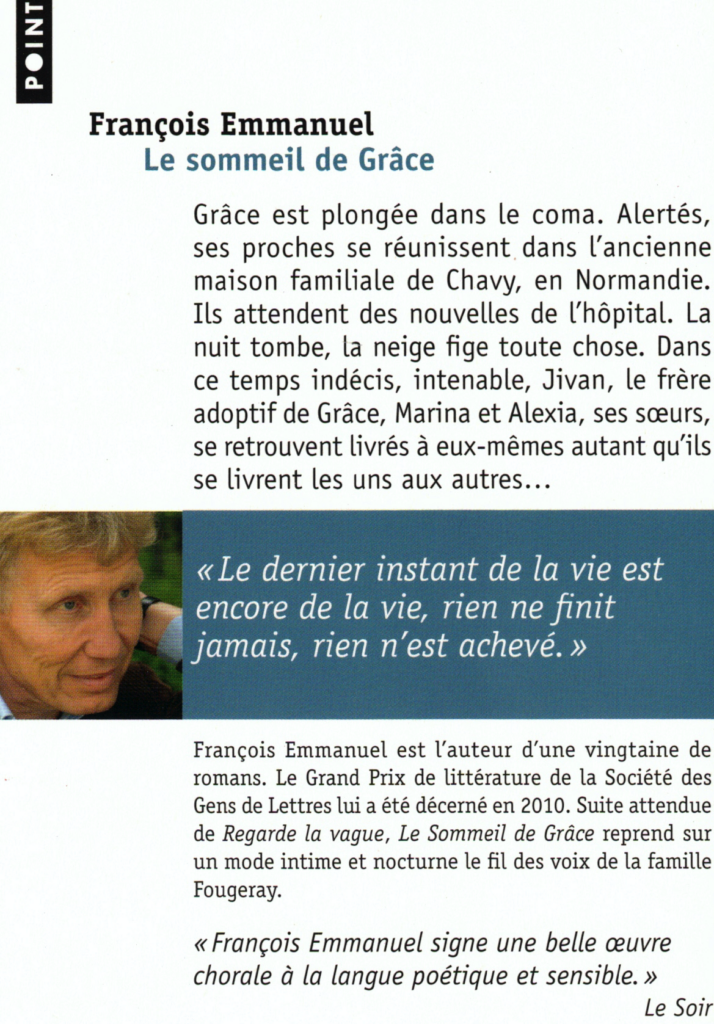

Édition: Seuil 2015
Réédition en Points, P4302
« (Alexia) … Et tandis que Marina déroule l’habituelle histoire, récit, saga des malheurs du grand frère, Jivan se tournant vers sa blonde pour traduire amoureusement : elle parle de notre frère aîné, Alexia se sent décrocher doucement, se souvenant que le père aimait dire à propos d’Olivier : mieux vaut qu’il se passionne pour les chevaux que pour les voitures, là au moins il y a de la beauté. Lire la suite
Encore qu’il n’est pas si certain qu’Olivier fût sensible à la beauté, se dit-elle, à l’instant où elle avise au-dessus de l’archelle cette vieille photo de famille rapatriée de l’ancienne chambre des parents, et posée là coins recourbés par la chaleur au milieu des pots à épices, avec l’alignement des cinq enfants, tailles en escalier, devant les deux statures tutélaires de papa et maman, Marina qui doit avoir alors quatorze ans, Olivier treize, Pierrot absent déjà, mort trois ans plus tôt, mais ce petit frère indien qu’elle tient par la main à l’extrémité de la ligne, et juste à côté d’elle Grâce en léger décrochage, lui semble-t-il, comme s’il était écrit que Grâce partirait la première, Grâce un pas en avant sous l’immense ciel blanc qui occupe les deux tiers de la photo, parce que les arbres du verger n’existaient pas encore, et l’on ne regarde jamais assez le ciel qui pèse dans les photographies, se dit-elle, tandis que Marina poursuit toujours ses explications à propos des démêlés du couple Olivier-Lynn, ou de ce qu’Olivier en a bien voulu lui révéler lorsqu’il lui a expliqué au téléphone qu’il avait leur fille le dimanche, ce qui sous-entendait qu’il ne l’avait pas les autres jours, qu’ils vivaient donc séparés, le dernier mot articulé par Marina dans le souffle, pour ne pas que Lili l’entende, et à cet instant précis où s’ouvre un nouveau silence, émaillé de tintements de couverts, Alexia retrouve tout à coup une marque mémorielle très précise, impression de déjà-vu ou de déjà-perçu, six ans auparavant, à la veille du mariage d’Olivier, lorsqu’ils étaient tous autour de la même table, et que de ce point-de-vue identique elle apercevait les images du téléviseur rencogné au fond du salon sombre derrière l’enfilade des deux portes ouvertes, se faisant la réflexion qu’au fond ce qui nous est donné comme la réalité du monde (ici des vues du désert liées sans doute à la prise d’otage sur le site algérien) n’est jamais que l’habituel concentré d’images, avec une dramaturgie similaire, de semblables protagonistes, dans un décor que l’on ne peut pas ne pas reconnaître : dunes, entrelacs de pipelines, baraquements, silos, clôtures, armes alignées sur une bâche, le portrait brouillé d’un barbu en chèche, l’alignement de miliciens cagoulés, fusil mitrailleur pointé vers le ciel, une foule en transe portant un cercueil ouvert, un visage indistinct derrière les vitres fumées d’une voiture noire…, et ce qui nous aimante là, se dit-elle, tient au fait que chacune de ces scènes en dissimule une multiplicité d’autres, dont n’affleure jamais que cette devanture lisse, programmée, ce morceau choisi toujours le même, comme si nous savions pertinemment que tout se passait dans les coulisses du théâtre mais que nous n’en voulions que le théâtre, et comme si la fascination pour ces images se nourrissait de leur hors-champ énigmatique, que nous aimions les regarder comme pure vérité et pure apparence, ici et ailleurs au même moment, indispensable présence de la tragédie du monde sous le tranquille vase de fleurs, dans l’encadrement paisible du mobilier mural, et tout à la fois vivante iconostase derrière laquelle officient les célébrants, les prêtres, les journalistes, les gens de pouvoir… Puis le téléphone a sonné. (Jivan) Cette vieille mécanique enrouée qui raclait le fond sonore depuis le couloir, et Marina s’est levée d’un bond. Pendant un long moment on n’a presque plus rien entendu, simplement l’apostrophe inquiète de sa voix, tandis que tous ici retenaient leur souffle parce qu’on ne pouvait pas s’empêcher de penser au pire, que l’annonce du pire prendrait la forme d’un tel appel au vieux téléphone de la ferme, mais la voix de Marina était plutôt tranquille, ponctuant à intervalles par un acquiescement, au point qu’il avait pensé un instant qu’Olivier appelait d’Angleterre, puisqu’on venait d’en parler, mais il s’agissait de Franz de toute évidence, à entendre les inflexions de Marina, prudentes, toute en retrait et en écoute. (Marina) – C’est toi le médecin, Franz… – Je viendrai demain matin. C’est plus facile maintenant que Dora est rentrée. – Et comment va-t-elle, Dora ? – Un peu gênée par la minerve. Anne est là aussi. Ça fait du bien d’avoir les deux filles à la maison. Tu sais, Marina… – Oui… – Il y a quelque chose qu’il faut que je te dise, c’est compliqué d’en parler au téléphone mais voilà…, c’est Dora qui m’a mis sur cette idée. Dora, elle a un trou de, mettons…, trois, quatre heures. Elle se souvient très précisément de la traversée d’Auderville et que Grâce avait parlé de mon cadeau d’anniversaire. Excuse-moi, ça me reprend comme un con… Dora…, Dora elle a un truc qui lui revient dans la tête, c’est comme une espèce de cauchemar et ça la réveille, elle se voit dans la voiture à côté de Grâce et elle voit quelque chose qui fonce sur elles, elle dit une tache noire parce qu’elle ne peut pas donner forme à ça, ça va trop vite, c’est une tache et puis plus rien… Moi je pense, je pense même avec certitude que c’est une voiture dans l’autre sens, une voiture folle ou une voiture fantôme, j’en suis de plus en plus certain, ça ne me lâche pas parce que c’est la seule explication… Grâce, je la connais, c’est une très bonne conductrice…, je sais qu’elle n’aurait pas donné un coup de volant aussi brusque si…, il suffit de voir les traces de freins… Alors je dis, on ne me l’enlèvera pas de la tête : il y a un type qui a joué à foncer sur elle et… Y a un cinglé qui… Excuse-moi, Marina, excuse-moi… – C’est normal, Franz. – Je te saoule avec mes histoires. – Essaie de te reposer, surtout. – Si j’y arrive. Alors tu m’excuses encore pour la réunion, tu les embrasses, le frangin, la frangine. Tu leur dis à demain. – À demain, Franz. (Jivan) Seule et si pâle au centre des regards, avec toujours ce lointain sourire qui est la garde flottante de son visage, elle reprend sa place à table, cherche des yeux le saladier, murmure dans un souffle : Franz vous embrasse bien, il viendra demain matin, sans autre explication, le regard un peu fixe, les mains un rien tremblantes quand elle se ressert de salade, puis le brouhaha reprend peu à peu, Juan profère un marmonnement dont seule Lili a saisi le sens depuis l’autre bout de la table : il attendra bien pour le vin, le petit père…, Ioulia disparait sous la ligne de la nappe, laissant tomber sa tête sur les genoux de sa mère, à l’instant où Jivan sent la main d’Alexia tapoter la sienne d’un doigt joueur, complice, un doigt léger d’autrefois, des temps d’insouciance : ça te dit, un tour sur la plage ? (Alexia) Neige mortelle, suis enfin arrivée à Chavy, tu avais raison, c’était risqué, Alexia efface, retape lentement : j’ai aimé faire l’amour avec toi, simplement pour voir la chose écrite, là sur le petit écran luminescent, et ressentir une vague chaleur, avant d’étendre le blanc à rebours lettre après lettre dans le corps du message, puis demeurer un long moment à ne plus savoir aligner le moindre mot, une pensée appelant son contraire, un signe, son annulation, ces mots, ces simples mots faire l’amour aussitôt révoqués par la pensée qu’il ne faut jamais dire ces choses, ne jamais céder à l’aveu, et dans cette chambre du deuxième, sinistre bonbonnière glacée donnant sur le grenier de la ferme, avec son sommier criard, son aiguière de porcelaine, son abat-jour flammé, son papier-peint vieillot à motif de paysanne bleue, répété jusqu’à la nausée sur le plafond et dans les encoignures, elle se revoit assise sur le même lit trente ans auparavant, au milieu des même motifs de jeune fille champêtre, nouant sur ses genoux la même gerbe de blé, sauf que la chambre était à l’époque beaucoup plus grande, cernée par le noir des combles, entourée de nuit et de mystère, alors que tout se réduit à présent au décor poussiéreux d’une antique chambre de vacher, avec cette impression d’empêtrement de sa pensée, ce sentiment de ne plus savoir où est son désir, elle qui sait toujours, que dire ou ne pas dire, que donner ou ne pas donner, parce qu’on ne peut pas donner le fond de ses choses à soi, parce que donner se donner c’est disparaître, monsieur mon psychanalyste Epstein, jusqu’à ce que dans un sursaut elle revienne au cadran pour taper d’un trait : puis-je dormir chez toi cette nuit ?, envoyant le message sans le relire avant d’éteindre rageusement le portable. (Marina) La porte du garage qui derrière Marina piaule tandis que le faisceau de sa lampe-torche balaie le vieux trois-corps du salon, les pattes emmêlées des anciennes chaises de la cuisine, les caisses de livres et de vaisselle, à la recherche du petit radiateur électrique bombé, brun, dont les résistances grillaient jadis les insectes, dans une sulfureuse odeur de brûlé, mais l’appareil n’est nulle-part, de très anciens registres cartonnés s’empilent dans une baignoire d’enfant et un tout petit sac en skaï à la tirette-éclair béante lui fait tout à coup penser à la pochette rouge du père qu’elle est allée chercher la veille au commissariat de police de Cherbourg-Octeville et qu’elle a à peine osé sortir de son enveloppe matelassée, dont elle n’a encore parlé à personne. Car comment parler de cette chose ? À qui en parler ? Quand trouver le moment ? Tout au fond du garage, adossé au mur de briques, il y a le vieux piano dont machinalement elle soulève la couverture kaki, basculant le couvercle d’ébène, posant ses mains sur le clavier glacé comme son vieux professeur Augustino Saba qui souvent caressait les touches sans les enfoncer, s’exclamant quel monde, Marina, quel monde sous ces touches muettes… Et voici que ses doigts détachent note après note la troisième Gnossienne de Satie, c’est comme le réveil hésitant, fissuré, d’un chant très ancien, dont ne survit ici miraculeusement que l’inflexion en fausset, le même pas fêlé et sublime que quand elle jouait les dimanches après-midis, fenêtres grandes ouvertes sur le ciel d’été, sauf qu’ici le silence étrangle, elle touche la peau d’un corps trop sensible, étonnée pourtant de retrouver naturellement le chemin de cette troisième Gnossienne, un peu fausse mais intacte encore : quelqu’un marche dans la maison aux espaces tronqués, méconnaissables, tandis que par le jeu des assonances elle se sent glisser vers une danse de Federico Mompou à propos de laquelle Augustino lui parlait, se souvient-elle, du rythme, que le rythme ne commandait rien, qu’il respirait sous la danse, mais que la danse ne pouvait l’ignorer, les tremblantes arabesques de Mompou s’accordant avec bizarrerie mais s’accordant cependant dans un écart fragile, puis se collisionnant, s’éparpillant dans le vide, avant que peu à peu le silence ne retombe. Et au moment où elle referme le couvercle elle repense à ce que lui disait son ami Mauro à propos de ce qu’il appelait el sonido doble, le son aigu venant en surplomb du son grave et donnant à l’ouïe, expliquait-il, cette curieuse sensation d’espace, d’élévation. Au fond, il doit y avoir un poème de Roberto Juarroz qui parle du sonido doble, se dit-elle, et ce serait une belle idée d’offrir à Mauro un volume des Poesia Vertical, qu’il ne connait peut-être pas, tandis qu’elle redispose la couverture sur le piano et que lui reviennent en mémoire les premières notes du Jardin Féérique, cinquième pièce enfantine de Ravel, avec Grâce sur un tabouret à sa droite, surélevée par un coussin, qui frappait les touches claires. » P.30-37